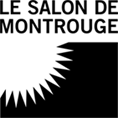Aïda Bruyère
Vit et travaille à Paris. Née au Sénégal en 1995
Aïda Bruyère a grandi au Mali et son premier élan de plasticienne s’est porté sur la société malienne. A travers l’édition et les images imprimées, l’artiste travaille d’abord avec les moyens rudimentaires et populaires du téléphone portable, souvent en caméra cachée, pour en tirer des clichés photographiques.
Inspirée par la télé-réalité, elle montre l’extravagance de la bourgeoisie malienne en décrivant, dans son roman photo Bakou, l’univers de Mamadou Coulibaly, fils d’une des plus grandes fortunes de Bamako, vivant dans un château calqué sur les demeures françaises. Toute la culture américaine du gangsta rap et des clips sont réappropriés par ce jeune homme qui montre l’autre visage de l’Afrique de l’Ouest, celui auquel on est encore peu habitués et à travers lequel le tabou occidental de la richesse éclate au grand jour. Dans sa vidéo L’argent de ma mère, elle a filmé les liasses de billets que sa mère palpe chaque matin en comptant sa recette pour transformer ces scènes en une fiction sur la mafia et sur le Franc CFA - depuis longtemps controversé dans ces anciennes colonies qui réclament une monnaie indépendante vis-à-vis de la France, encore maîtresse de leur économie. Puis, c’est autour de 2015, peu après son arrivée dans l'hexagone, que l’artiste découvre la danse Bootyshake qui la fascine d’emblée, tant pour l’attitude sexy que pour l’apparence vestimentaire qu’elle suppose. A partir de sa pratique de cette danse de rue, elle découvre des battles de dancehall exclusivement féminins dont elle tire, dans son projet Special Gyal, un inventaire des mouvements et des postures. Ce travail l’amène à une implication totale dans l’exploration de cette sous-culture populaire que certaines femmes se sont appropriées en allant à contre-courant des paroles sexistes et violentes de la musique qui l’accompagne, trouvant ainsi leur empowerment.
L’artiste fait entrer dans les codes de l’art contemporain ces cultures alternatives - qui ont cette qualité de se régénérer en permanence et d’irriguer la mode - pour mieux mettre en valeur les créateurs de ces mouvements, vivant souvent dans la précarité, mis à l’écart et littéralement sucés par l’industrie culturelle.
Juliette Soulez