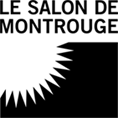Joris Heraclite Valenzuela
Né à Paris en 1994.
Vit et travaille en région parisienne.
Diplômé de l’École des beaux-arts de Paris.
Joris Valenzuela a tissé des liens intimes avec la cité de Montreuil qu’il habite depuis son enfance et c'est très naturellement qu'il s'en inspire pour produire ses œuvres. Il utilise des matériaux pauvres et endogènes : noir de fumée, plantes rudérales (celles qui poussent sur les gravats et les espaces abandonnés) et autres organismes qui prolifèrent sur les façades décrépies et bientôt « ripolinées » des HLM de la petite couronne parisienne, puis du Grand Paris.
Rien ne prédestinait Joris Valenzula, né d'un père chilien exilé sous la dictature de Pinochet devenu ouvrier en bâtiment et d'une française Nordiste, à entamer des études en école d'art. C'est d'abord au Mans puis aux Beaux-arts de Paris qu’il développe une sensibilité au vivant autant qu'à l'architecture. Il aime lier les êtres et les choses, la mémoire et la transmission, et composer avec la fragilité et la résilience des barres d'immeubles de son enfance à La Noue – Clos-Français. Cette cité, considérée comme « maltraitante et maltraitée » selon les mots de Marielle Macé[1], est l'intarissable source d'inspiration ce jeune artiste curieux des pratiques de son voisinage multiculturel, coincé dans l'un de ces quartiers où la France enclot certain·es de ses citoyen·nes.
Joris Valenzuela fait partie de celles et ceux qui maintiennent, entretiennent, cultivent, prélèvent et recomposent, à partir d'éléments aussi bien physiques que mentaux, les liens dans ce quartier périphérique. Son nom, « la noue », est d’ailleurs parfaitement signifiant. Il désigne des espaces mouvants entre terre et rivière qui permettent de réguler naturellement la montée des eaux et d'ainsi conserver les biotopes. Ces espaces de jonction sont « comme autant d'arches, arches d’eaux vives et de pratiques, où conserver non pas des choses mais des forces[1] ». Joris Valenzuela participe précisément de ce mouvement invisible, mais non moins puissant, qui favorise l'empowerment de ces espaces vulnérables et de leur habitant·es. À leur côté, il se familiarise avec les savoirs vernaculaires concernant les plantes rudérales et leurs vertus, en s'imprégnant des pratiques de ses voisin·es asiatiques comme celles de sa famille Mapuche.
« Mes pièces ont le point commun d’être toutes réalisées à partir de matériaux pauvres, fragiles, instables, dont la pérennité n’est pas, ou difficile à assurer, comme la mémoire », dit-il. Aussi, ses pièces ne sont pas destinées à durer. Elles sont imprégnées pour certaines d'entre elles des pratiques de soins collectifs, des rituels de reliance et de guérison. Ses toiles noircies à la fumée de bougie sont en fait des plans, des chemins de traverse qu'il empruntait enfant à travers sa cité, se référant aux graffitis réalisés au briquet qui se retrouvent fréquemment dans les halles d'entrée des immeubles de la cité. Ainsi, le plus souvent brulées et donc trouées, ses toiles tendues sur châssis ne résisteront guère aux épreuves du temps, pas plus que ses installations à partir de plantes rudérales ou ses silicones qui viennent recueillir, telles des empreintes, les mousses qui poussent dans les failles, les interstices du béton.
Entre mues et pansements, ses silicones autant que ses toiles et installations à base de plantes témoignent d'une observance et d'une extrême bienveillance pour toutes les formes de vies (humaines et non-humaines), qui persistent et signent l'espoir au sein d'une cité des possibles.
Béatrice Josse